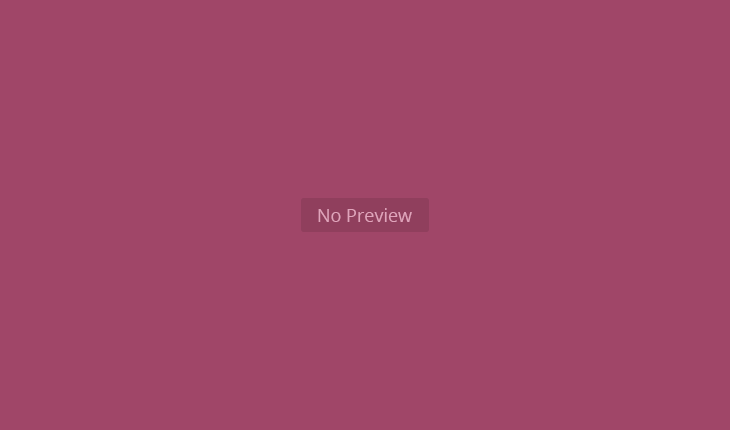Mansou Mhenni
La commémoration du quatrième anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd, promu de ce fait au statut de « martyr de la nation », n’a pas dérogé à l’habitude en réactivant des débats plus ou moins tendus, selon les participants, plus ou moins inscrits dans l’une des deux tendances en présence pour la gestion de l’affaire Belaïd, la force de récupération politique et celle de la recherche de la vérité.
Soulignons d’abord un détail important : certains commentateurs, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, répondent parfois aux discours panégyriques à la mémoire du défunt par des remarques portant sur sa vie privée, sur son idéologie de base et d’autres détails par lesquels ils voudraient relativiser l’aura laudative qui entoure son image de martyr. De quelque côté qu’on se place par rapport à cet état des choses, il conviendrait de partir du principe que comme tout un chacun, Chokri était homme et rien d’humain ne lui était étranger. Par conséquent, on ne pourrait reprocher, à l’homme qu’il était, que ce qu’on devrait d’abord se reprocher, chacun à soi-même. « Hypocrite lecteur, — Mon semblable, — mon frère ! », a dit Charles Baudelaire à l’entrée d’un espace de communication cher à Chokri Belaïd, celui de la poésie.
Cependant, les circonstances ont voulu que cet homme, à première vue comme tous les hommes, soit tué pour des raisons politiques, par une main criminelle, apparemment une main occulte et plurielle. Or une telle mort fait de la victime un martyr, d’abord de la famille politique à laquelle il appartenait, mais aussi de tout le pays, le nôtre, qui cherchait alors à franchir le cap pour la démocratisation et qui voit soudain l’un des siens se faire assassiner sur l’autel même de la démocratie. Ne l’oublions pas, cet assassinat était le premier du genre dans notre pays et, malheureusement pas le dernier ! Dès lors, la cause de Chokri Belaïd est hissée au statut de cause collective débordant le cadre idéologique pour couvrir l’espace public national où se muent les libertés communes en armes de lutte pour la vérité.
De ce point de vue, aussi légitime que soit l’attachement de la famille politique à son martyr, force est pour cette famille de reconnaître qu’elle doit le partager, comme valeur, avec tous les Tunisiens qui voudraient se retrouver, ne serait-ce que partiellement, dans le symbole qu’il est devenu aujourd’hui.
Symbole il est et symbole il restera tant que des Tunisiens continueront de vibrer pour la valeur qu’il représente le plus à présent : la Vérité ! En effet, au-delà de toute forme et de toute dimension de l’engagement politique, le sien ou celui de ceux qui se reconnaissent de son martyre, Chokri est désormais l’indicateur certain d’une défaillance de la vérité dans nos contrées. Tirer au clair les tenants et les aboutissants de sa mort hantent la plupart des Tunisiens. Mais plusieurs inconnues persistent pour suspendre la confirmation d’un scénario paraissant tout clair pour la plupart des gens. Et le plus pénible dans cette situation, c’est que le doute qui persiste n’est, semble-t-il, pas dû à un manque de preuves, mais à une dissimulation de preuves.
Ainsi, tant que ce doute continue, nous devons vivre avec la conviction coupable que la politique est par excellence le champ du mensonge.
Mansour M’henni