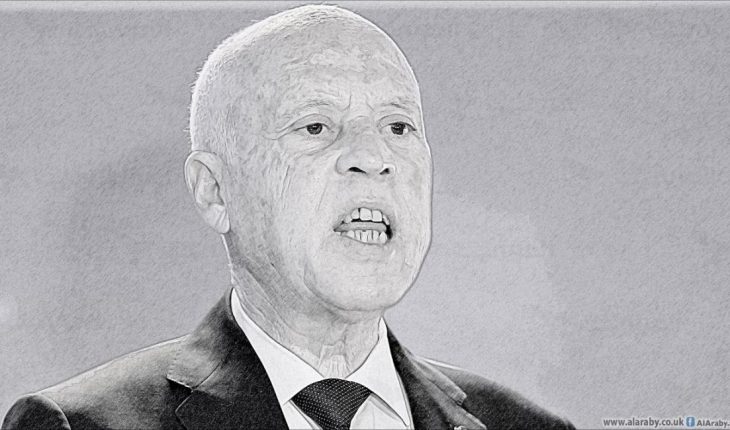Sadok Belaïd, le président de la commission consultative sur la nouvelle Constitution, dénonce, dans un entretien au « Monde », le texte finalement retenu par le chef de l’Etat Kaïs Saïed.
Le constitutionnaliste Sadok Belaïd, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques de Tunis dans les années 1970, avait été nommé fin mai par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à la tête de la commission consultative chargée de rédiger la nouvelle Constitution. Il a remis le 20 juin au chef de l’Etat son rapport sur le projet de Loi fondamentale qui devrait être soumis au référendum le 25 juillet, premier anniversaire du coup de force de M. Saïed à la faveur duquel ce dernier avait imposé un régime d’exception.
Or le texte rendu public le 30 juin par le chef de l’Etat, s’il s’inspire des propositions de M. Belaïd sur un renforcement des pouvoirs présidentiels, s’en éloigne sur un certain nombre de points. Dans un entretien au Monde, M. Belaïd prend ses distances avec le projet présidentiel, qu’il juge « dangereux ». Le constitutionnaliste dénonce en particulier le risque que s’établisse une « dictature sans fin au profit du président actuel ». Il s’inquiète en outre d’une possible « reconstruction du pouvoir des religieux » et donc d’un « retour aux âges obscurs de la civilisation islamique ». Il s’alarme enfin du risque d’« anarchie » avec l’idée de M. Saïed de « la construction de la démocratie par la base ».
Quelle est votre réaction au projet de Constitution du chef de l’Etat qui était censé s’inspirer de votre propre avant-projet remis le 20 juin ?
Je regrette qu’il y ait une très grande distance entre les deux textes.
Qu’est-ce qui pose problème à vos yeux ?
D’abord, la relance d’une polémique inutile sur l’identité nationale. Ensuite, éparpillée sur l’ensemble du texte, la tendance à la tyrannisation du pouvoir.
La tyrannisation ? Vous dites que le pouvoir risque de devenir une tyrannie dans le projet présidentiel ?
En effet, le pouvoir est en train de s’orienter, à travers le soi-disant principe du présidentialisme, vers l’établissement d’une sorte de dictature sans fin dans le pays au profit du président actuel. Le texte présidentiel peut lui donner la tentation de renouveler son mandat après son expiration en cas de « danger imminent ».
Votre projet prévoyait la destitution du président dans une éventualité : s’il devait limoger le gouvernement une seconde fois. Vous ne lui accordiez cette possibilité qu’une seule fois. Cette limite a apparemment disparu.
Oui, notre texte donnait au président le privilège de désigner le chef de gouvernement qui lui plaît, mais lui en laisse la responsabilité. En somme, on lui donne une tolérance. S’il a fait le mauvais choix, on lui donne une deuxième cartouche. Mais si la deuxième fois, ça aboutit au même résultat, c’est-à-dire l’échec et la rupture, alors on lui dit : « Monsieur, vous n’êtes pas digne de nommer un chef de gouvernement. Aussi on vous demande de vous éclipser ». A l’époque, je peux témoigner que le président était oralement d’accord avec une telle éventualité. Ce que je regrette énormément, c’est qu’il l’a omise dans le texte rendu public. Dans notre texte, le président devait assumer la responsabilité de ses actes et des pouvoirs qu’on lui a donnés. Il y a certes un certain respect vis-à-vis de la fonction présidentielle mais il ne faut pas qu’il devienne un alibi à l’impunité et à l’irresponsabilité.
Vous évoquiez la relance d’un débat inutile sur l’identité nationale. Faites-vous référence à l’article 5 de son projet sur « la Tunisie fait partie de la Umma [communauté des croyants] islamique. Seul l’Etat devra veiller à garantir les objectifs de l’islam » ? Si oui, quel en serait le risque ?
Le risque est son utilisation orientée vers un conservatisme rigoureux, vers un retour aux âges obscurs de la civilisation islamique. Le risque est dans une reconstitution du pouvoir des religieux et des extrémismes religieux qui en ont découlé. Il y a une très grande différence à ce propos entre les deux textes. La culture qui prédomine en Tunisie, c’est une culture de modération, d’ouverture et de tolérance et non pas de la mise en place d’un pouvoir religieux qui n’a été que rétrograde et anti-démocratique.
Le projet présidentiel vous a pourtant suivi dans la suppression de l’article 1er de la Constitution de 2014 qui stipule : « La Tunisie est un Etat libre et souverain, sa religion est l’islam ».
M. Saïed en a retiré l’accent mis sur « l’Etat » pour le ramener sur « la communauté [des croyants] ». Or cette notion de « communauté » est très ancienne et elle n’a pas de sens culturel dans le monde actuel, le monde arabo-musulman entre autres. Ainsi risque-t-on d’aboutir véritablement à une reconstitution de l’extrémisme religieux présenté sous une autre forme, celle de l’unité d’une communauté assise sur un pilier unique, la religion. La majorité des Tunisiens sont certes musulmans. Mais, je le répète, cette majorité de Tunisiens musulmans sont très tolérants, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays arabes.
Vous aviez beaucoup insisté dans votre projet sur l’impératif économique. Qu’est-il devenu dans le projet de M. Saïed ?
Là encore, il y a une grande différence. Mon texte était marqué par la centralité de la préoccupation économique, sociale, culturelle et écologique. M. Saïed l’ignore. Il a une vue politique de la crise qu’on traverse. Il est à côté de la plaque. Il ne comprend rien aux affaires actuelles, à la maladie actuelle du pays qui est économique, sociale, culturelle, écologique. Ce n’est pas une maladie politique. On ne peut pas dire : « on va améliorer l’organisation politique pour que le pays marche mieux ». Pas du tout. C’est comme si vous donniez une aspirine à un cancéreux.
Votre projet proposait la création de quatre régions avec l’élection au suffrage direct d’assemblées régionales chargées du développement économique. Et, au niveau national, un Conseil économique et social, sorte de deuxième chambre, aurait été formé pour partie de ces élus régionaux. Quel sort le projet de Kaïs Saïed a-t-il réservé à votre idée ?
Il a en fait supprimé l’institution du Conseil économique et social. Et il a fait de la régionalité le point central de la réorganisation des pouvoirs. Or cela est dangereux. Car si on n’intègre pas ces nouvelles régions dans l’unité nationale, le régionalisme peut un jour ou l’autre prédominer et contribuer à fracturer le pays.
Pourtant, il établit – à la place de votre Conseil économique et social – un Conseil national régional et territorial qui, lui aussi, se forme à partir des élus régionaux, ce qui n’est pas très différent de votre schéma.
Mais le texte de M. Saïed ne met pas l’accent sur l’unité du pays. Mon texte part du principe inverse. D’abord : nous posons une vision politiquement unie du pays. Ensuite, nous élaborons une vision unie des stratégies de développement dans lesquelles s’intègrent les régions. Il y a une grande différence entre les deux visions.
Un autre problème se pose avec l’Assemblée nationale – l’Assemblée des représentants du peuple – dont le mode d’élection est flou. Le texte de M. Saïed ne précise pas si cette première chambre sera élue au suffrage direct, alors que votre projet était très clair sur ce point. Cela vous inquiète-t-il ?
Cela n’est en effet pas précisé. Et sans cette précision, il peut tout faire de ce texte. Alors qu’il aurait été plus simple et plus direct d’affirmer que les élus qui vont être envoyés à l’Assemblée représentent une nation, une nation unie. On peut imaginer tout autre chose avec le texte de M. Saïed.
Cette question en amène une autre, celle du bicaméralisme. Vous étiez favorable à un bicaméralisme où l’Assemblée nationale aurait disposé du dernier mot face à la deuxième chambre. Or là, encore, le projet présidentiel ne semble pas retenir votre idée.
Son projet renvoie à la théorie plus ou moins fumeuse de la « construction de la démocratie par la base » qui nous promet une sacrée pagaille. Alors que notre projet était celui d’un bicamérisme déséquilibré. Le bicaméralisme ne peut pas marcher s’il n’est pas déséquilibré. Aux Etats-Unis, le Sénat américain cède le dernier mot à la Chambre des représentants. En France, le Sénat cède le dernier mot à l’Assemblée nationale. En Angleterre, la Chambre des lords cède le dernier mot aux Communes. Pour la Tunisie, notre idée était de dire : il y a deux assemblées mais il faut qu’elles fonctionnent ensemble. Et si elles ne fonctionnent pas ensemble, il y en aura toujours une pour imposer le dernier mot. Il n’y a rien d’original.
Du coup, quelle serait la conséquence pour la Tunisie de cette absence de bicaméralisme déséquilibré ?
Cela va nous amener à une belle anarchie dans le pays. Il y aura une assemblée qui agira et réfléchira politiquement et une autre qui réfléchira en termes de concurrence économique entre les différentes régions. Si on ne tranche pas, il y aura, un jour ou l’autre, une région qui va prédominer dans le reste du pays. Et actuellement, c’est parfaitement plausible et c’est prévisible. On parle souvent des cinquante familles en Tunisie [qui domineraient l’économie nationale]. Or ces familles sont concentrées dans le petit Tunis : Sidi Bou Saïd, Tunis, Ben Arous, etc. Et le reste des pays sera plus ou moins ignoré.
Dans ces conditions, que faudrait-il faire maintenant ? Vous demandez à M. Saïed de revoir sa copie ?
Je demande simplement qu’il annule son projet, qui a une valeur déplorable. C’est tout ou rien. Soit il fait machine arrière. Soit il fait des petits bricolages ici et là pour maintenir sa vision initiale erronée.
Annuler son projet et reprendre la consultation ?
Oui, il faut relancer le débat auprès de l’opinion publique sur l’ensemble de la construction du pouvoir dans notre pays.
Relancer le débat à travers un dialogue plus large que celui qui avait existé ?
Tout à fait. Malheureusement, on a attendu une année depuis le 25 juillet 2021. On espérait qu’on ferait des progrès. On n’a pas avancé, on a reculé.
Avec quels partenaires cette relance du dialogue pourrait-elle se faire ?
Je ne suis pas un démagogue. Je suis un élitiste, je vous le dis très franchement. Je pense qu’il existe en Tunisie une élite de très grande valeur qui est capable de diriger ce pays si on lui en laisse la possibilité, si on lui en donne l’occasion. A mon avis, la réflexion doit donc se faire à partir de cette élite. Les résultats des débats au sein de cette élite pourraient ensuite être soumis à l’approbation ou à la désapprobation de l’ensemble de la communauté nationale.
Vous évoquiez la vision erronée du président ? Comment qualifiez-vous ce modèle idéologique ?
Idéologiquement, il s’agit d’un modèle rétrograde et dépassé. Malheureusement, l’idéologie se trouve aujourd’hui au pouvoir avec M. Saïed. Et ça, c’est mauvais
Propos recueillis par Frédéric Bobin
Ecoutez la déclaration d’aujourd’hui du doyen Belaïd à Shems.Fm