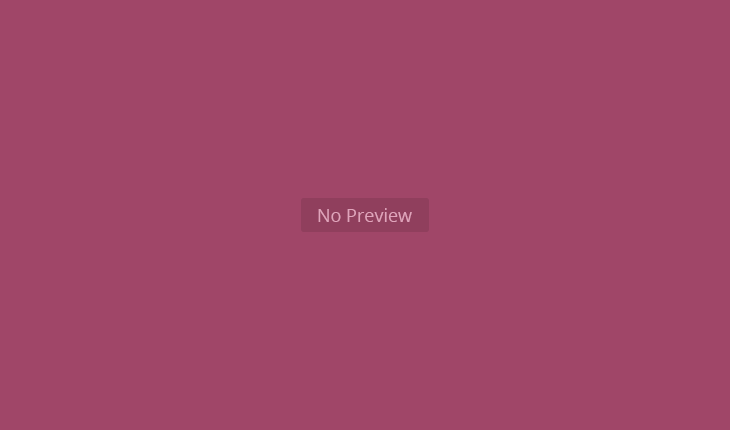Mansour Mhenni
C’est une vraie bombe politique et médiatique qu’a lancée le président de la République Béji Caïd Essebsi à l’occasion du 61ème anniversaire du Code du Statut Personnel, marchant ainsi sur les pas de son modèle, son père politique et spirituel, le leader Habib Bourguiba. On annonçait une surprise et c’en fut une, au moins pour une bonne tranche de la population tunisienne, mais sans doute aussi pour la part la plus large de la population arabo-musulmane !
Depuis, chacun y va de son petit effort d’interprétation et même de sa plus ou moins grande spéculation sur l’avenir, allant même jusqu’à la mise en danger de la vie du Président et à la mise en péril de l’équilibre à peine retrouvé de l’Etat tunisien. Le principal indicateur à retenir de cette situation inopinée, c’est que la société arabo-musulmane reste par trop classique quant aux lois qui sont censées la gérer et par trop rigide quant à la discussion même, de façon sereine et rationnelle, de certaines questions systématiquement comptées de l’ordre du sacré et du tabou intellectuel. Or c’est à deux de ces questions les plus brûlantes que s’est attaqué BCE, avec une audace que d’aucuns comparent à celle de Bourguiba, mais que d’autres trouvent mal calculées par rapport au contexte.
Il est évident qu’il y a à prendre et à laisser dans les attitudes et les arguments des uns et des autres quant aux questions soulevées par le Président, mais il y a surtout à relever la relance, de façon essentielle, jusqu’à la crise, du débat souvent caressé dans le sens du poil entre le sacré et le profane, entre le religieux et le politique… Dès lors, la question centrale devient : peut-on discuter l’interprétation coranique – ce qui ne veut pas dire discuter le Coran qui, dans l’état où il est, est un texte ainsi arrêté dans sa composition (a postériori) et mis à la disposition des croyants pour qu’ils y cherchent chacun la voie de son salut. Il va sans dire donc que l’interprétation peut varier, selon les moyens, la méthode et la perspicacité de chacun et que la responsabilité de chacun sera à la mesure de la sincérité qu’il a en traitant avec le Coran et non forcément sur la vérité d’un sens unique qui ne peut être détenu que par le Créateur du Coran, en l’occurrence Dieu, pour les musulmans. De là l’importance de l’Ijtihad qui devrait consister plutôt en une relativisation de la vérité humaine par rapport à l’Absolu de la Vérité Divine, et non en un suivisme aveugle derrière un quelconque autre interprétant qui s’octroie le pouvoir du texte par une simple maîtrise de la langue et qui, de ce fait, peut faire tout ce qu’il veut du texte et des croyants qui le suivent.
C’est là que m’interpelle une question de croyant, n’autorisant personne à faire de la surenchère sur sa foi, mais prêt à converser avec tout semblable croyant ; cette question est : Pourquoi Mohammed est-il le dernier des prophètes et l’islam, la dernière religion monothéiste ?
A remonter l’histoire de l’humanité jusqu’à l’étape de l’appréhension et de la saisie sensibles et intelligentes de l’existence, et par là même de l’interrogation existentielle liée à la condition humaine, on se rend compte qu’il y a un moment nodal où l’humanité a commencé à se libérer de la connaissance par le mythe, qui comprend aussi tout ce qui est de l’ordre de la croyance, pour s’intéresser à la connaissance par la pensée, qui comprend la philosophie et l’intelligence. Cette transition a duré les deux siècles séparant, en Grèce, les Sept Sages de Socrate, presqu’au milieu précis de la période séparant Moïse de Jésus.
De ce point de vue, la philosophie serait donc bel et bien née avec Socrate et aurait été concrétisée avec Platon ; mais la condamnation à mort du premier a constitué une vraie entorse dans le développement de l’intelligence philosophique, laissant l’homme dans un inéluctable tiraillement entre la quête de la sagesse dans et par la religion et sa recherche dans la philosophie, les deux interférant avec la politique tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire. Partant de là, on peut croire que Jésus et Mohamed soient venus transmettre à l’humanité les deux derniers messages célestes appelant à libérer la pensée humaine, à la déclarer capable d’évoluer avec ce qu’elle a acquis par le recours à la transcendance et alors à faire confiance à la Raison.
Sans entrer dans un long développement qui trouverait mal sa place dans cet espace, je dis que cette idée m’interpelle et qu’elle me semble devoir en faire autant pour tous les croyants. On y trouverait peut-être les raisons d’un échange serein qui garantirait le respect mutuel et qui, entre le sacré et le profane, donnerait à César ce qui est à César.
Mansour Mhenni