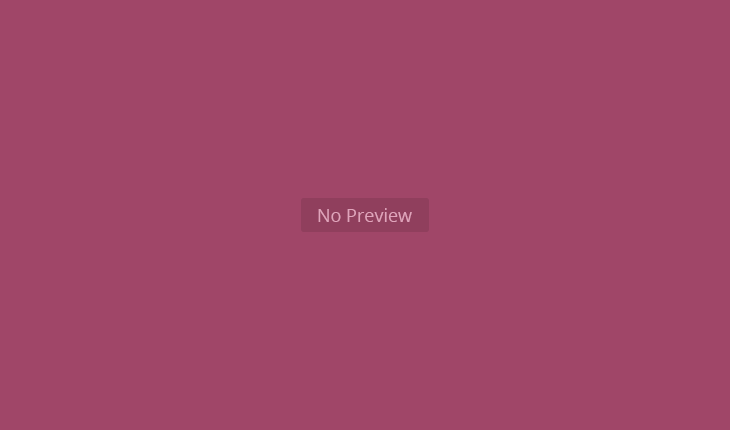Mohamed Hafayedh
(Cet article est un soutien à la commission Colibe et une contribution au débat d’un tunisien de Gauche qui pense l’Islam de l’intérieur de l’Islam)
Le débat autour du rapport entre l’état et la religion de l’article 1 de la constitution de Bourguiba divise encore les tunisiens. Le dépôt du rapport de la commission des libertés n’a fait que raviver les antagonismes d’une violence verbale allant jusqu’aux menaces de lapidation sur la place publique des membres de la commission.
Bourguiba a fait de l’islam la religion de l’État tunisien. Les islamistes exige un Etat islamique ni plus ni moins.
L’enjeu est la place de la charia dans la hiérarchie des normes du système juridique tunisien.
En Tunisie comme la plupart des pays musulmans la référence à l’islam n’a pas d’effets concrets sur l’organisation du pouvoir ou des institutions. La revendication des intellectuels laïcs d’une « Dawla madaniyya » : un « gouvernement civil » d’ascendance anglo-saxonne (le philosophe Locke) a finit par « séduire » même les frères musulmans tunisiens. Seulement, attention ! il ne faut pas se méprendre sur les motivations des frères musulmans. Ils rejettent la laïcité. L’état civil des frères musulmans n’est pas un état laïc. Selon l’essayiste libano-palestinien Ahmed Beydoun, au lendemain de la révolution du 25 janvier 2011, les frères musulmans égyptiens ont fait une tentative de récupération de la notion de « dawla madaniyya ». Une grande figure des frères musulmans Ahmed Salem qui signa du surnom d’Abou Fihr al-Salafi un petit ouvrage sur le « Civil-Government » où il explique que Ibn Taymiyya et d’autres docteurs ne reconnaissent le régime d’un Etat Islamique que pour les hommes au pouvoir qui « doivent bien avoir le Shar’ de Dieu pour unique référence. Alors que les gens qui sont nommés par d’autres hommes et non pas par décret divin ne sont à aucun titre infaillibles. Leur interprétation de la Loi, aussi bien que leur observance de celle-ci, restent, par conséquent, éminemment discutables. Leur pouvoir peut être dit « Civil »aussi bien dans la mesure où, ne pouvant se prévaloir d’une source divine, il n’est pas un pouvoir théocratique. », L’Etat de Moursi et de la majorité de son parti islamiste, explique Abou Fihra-Salafi, « n’est pas un état religieux ; c’est bien un Etat civil, ce qui ne devrait nullement l’empêcher d’être dit Etat Islamique ». C’est la définition et la théorisation du concept frères musulmans de l’état islamique-état civil.
Par contre l’état Islamico-Civil ne veut absolument pas dire un état laïc, la laïcité est la mécréance même. Abou Fihr-Salafi n’oublie pas de rappeler que le danger de l’état laïc vient du fait que les libertés individuelles sont au fondement même du concept de la Laïcité.
La référence à l’islam est donc utilisée par les fondamentalistes pour conditionner l’exercice de droits et libertés : le respect des droits de l’homme, de l’égalité entre l’homme et la femme.
Et à partir du moment où le référent religieux est évoqué pour conditionner des libertés individuelles, le débat devient un affrontement, un corps à corps, l’objet de la saisie pour les wahhabites devient existentiel : le corps de la femme.
Je cite le Professeur Ahmad Beydoun :« l’état religieux ou confessionnel prend pour point de départ la désignation symbolique des maitres et la délimitation du territoire qui est le leur et celui de la communauté de leurs sujets. Il voile les femmes et leur impose un code de conduite excessivement minutieux afin de projeter son pouvoir aux tréfonds des corps et des foyers. Or, dans les corps des femmes et la pénombre des foyers réside aussi l’honneur des hommes. Et c’est des hommes, placés sous surveillance dans leur honneur, que les détenteurs du pouvoir religieux se rendent maîtres en prenant le contrôle des femmes. »
Au premier trimestre 2012, Ennahdha a voulu inscrire la charia comme source de droit mais elle a été obligée de renoncer devant les manifestations et la mobilisation massive des femmes du 20 mars. la question a été remise sur le tapis lors du vote de la question et deux amendements ont été proposés le 4 janvier l’un proposant l’Islam , l’autre le Coran et la Sunna comme « sources principales de la législation » avant d’être rejetés. L’article 1 a été longuement débattu, les islamistes soutenant que l’Islam est la religion de l’Etat alors que les sécularistes affirmaient que l’islam y était consacré comme religion du pays, la société. Finalement le consensus a été pour le maintien de cet article tel qu’il a été rédigé.
Aussitôt le rapport Colibe est déposé les wahhabites et frères musulmans tunisiens s’opposent aux recommandations de la commission, comme si le corpus constitutionnel de 2014 n’existait plus, comme si l’égalité entre les hommes et les femmes vient juste d’être revendiquée par Tahar Haddad au milieu des années trente. Le discours de Noureddine Khademi, ancien ministre des affaires religieux, lors de la présentation de ses vœux de l’Aid Fitr est éloquent.
Certes, le discours islamiste est dépassé par la réalité sociologique et historique de la société et de la solidité de la position sociale de la femme tunisienne, cependant, leur argumentation simpliste, soit-elle, est claire pour le tunisien moyen, sa force tirée de la tradition de plusieurs siècles : Un Etat Islamique ni plus ni moins, l’exercice des droits et des libertés doit être légiféré et fait conformément aux principes de la charia islamique. Alors que dans le camps des « sécularistes », « laïcs », « modernistes », on est dans le dubitatif, incertains de nos formules comme par exemple l’Islam de l’article 1 a été consacré « comme la religion du pays » ou « religion de la majorité de la société tunisienne » ou encore un argument juridique : « pour preuve l’adoption d’un article 2 qui consacre le caractère civil de l’état qui dispose : la Tunisie est Etat civil , fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté de l’état ».
Les explications « sécularistes » ne résistent pas devant la force du concept de la transcendance théologique des islamistes, comme force écrasante et absolue : Dieu est Dieu.
Avant d’entamer le sujet deux remarques s’imposent : en premier lieu, il faudra affronter la question au fond, mettre les pieds dans le plat et engager la guerre des concepts. La question du Sujet confiant en lui-même et conscient validant la production des droits et des libertés est une question irréductiblement philosophique.
En deuxième lieu, il est urgent de faire sortir le débat sur les libertés individuelles de la guerre entre d’un coté l’esprit des lumières non croyant et de l’autre coté l’esprit soumis à la loi Schar’ de Dieu. Parce que « la philosophie des lumières n’est pas une doctrine, un système moins encore, et peut être même une philosophie. Des penseurs aussi matérialistes et athées que d’Holbach et Helvétius y voisinent avec des ennemis aussi déclarés de l’athéisme que Voltaire, Rousseau ou Kant. ». Force est de constater que le caractère « sacré » des droits de l’homme et aussi universels qu’absolu. Le devoir de les respecter, tout comme l’impératif catégorique chez Kant, ce devoir est si absolu. Dans l’esprit de Diderot pas de liberté morale si son exécution ne devait être sanctionnée par un suprême justicier, c’est-à-dire par Dieu lui-même (comprendre la foi en un Dieu et non pas la religion de l’église.(Diderot Encyclopédie) .C’est d’ailleurs, une telle liberté fondamentale de l’homme suppose pour le révolutionnaire Robespierre, l’existence d’un Être Suprême, aussi omniscient qu’omnipotent : « l’idée de l’Être Suprême et de l’immortalité de l’âme est un rappel continuel à la justice, elle est donc sociale et républicaine » (Robespierre, Discours du 18 floréal an II à la Convention)
Le rapprochement entre l’Être Suprême de Robespierre et Allah le Sublime est vite fait par le philosophe allemand Hegel quelques semaines après la l’avènement de la révolution Française. Les travaux très récents du philosophe hégélien Alain Patrick Olivier « Hegel et l’esprit de l’Islamisme (DCIE/MSH-2011) démontrent que dans son cours de philosophie de l’histoire, Hegel met en relation l’Islam, religion du sublime, avec l’évènement sublime de la révolution française.
Entendons-nous l’Islam, concept de l’Esprit Absolu, comme manifestation d’une rationalité pratique morale à l’œuvre dans le processus historique.
Vérifions, maintenant, qu’en est-il du concept bourguibien de l’Islam de l’article 1 de la constitution tunisienne?
Bourguiba est un homme d’état, dans son esprit comme dans l’esprit de ses premiers compagnons, la proposition : « l’islam est sa (l’état) religion » ne peut s’analyser que selon la conception de l’état nation moderne qui avait émergé de l’esprit des lumières européennes.
C’est Hegel incontestablement le philosophe de la théorie de l’État et plus spécifiquement des rapports entre l’État et la religion.
La théorie de l’état n’est pas chez Hegel simplement une « philosophie politique » – comparable à celle des autres maîtres de la philosophie politique (Machiavel, Hobbes, Montesquieu, etc.) le concept de l’État doit être compris comme un moment du mouvement à travers lequel « l’Esprit pensant de l’histoire du monde, en dépouillant ces limitations des esprits-des-peuples particuliers et sa propre mondanité, saisit son universalité concrète et s’élève jusqu’au savoir de l’esprit absolu »3
Sous l’impulsion de Goethe, Hegel découvre dans l’Islam l’alternative à sa problématique esthético-théologico-politique : une philosophie de l’Esprit capable de saisir philosophiquement « l’anomalie qui constituerait en soi tous les traits de la réaction conservatrice européenne afin de lui donner une libre et heureuse intériorité ».
Hegel théorise l’Islam comme la religion de l’UN qui ne peut être saisi que par la pensée, l’UN est donc une abstraction, un suprasensible situé au dessus de la nature et des existants. L’Esprit islamique, l’Esprit pensant de l’histoire du monde est d’établir le savoir de vivre dans l’UN.
La dimension affirmative de l’Islam est que l’homme se libère de sa naturalité, de l’esclavage et de la particularité. L’homme se comprend comme au dessus de la nature et son but, il se lève ainsi à la véritable conscience de soi. L’Islam est la religion de l’Esprit, de la pure pensée.
Quand à la dimension négative c’est la négation du principe occidental de la naturalité et de la concrétude. En conséquence une négation du particularisme de la religion de l’esprit accompli : le christianisme. (L’Islamisme de Hegel essai de Alain Patrick Olivier, déjà cité).
Si pour Hegel la religion chrétienne est une religion de l’Esprit et constitue pour la phénoménologie de l’esprit germanique le rapport à l’Absolu sous la forme du sentiment, de la représentation, de la foi, elle n’est nullement l’adoration d’un Dieu transcendant, d’un Dieu-objet extérieur à l’Esprit, c’est-à-dire extérieur à l’homme, l’Être qui est en soi le divin : L’Etre-Un de « la religion du sublime », c’est Allah de la religion musulmane.
S’agit-il pour autant de deux religions à la fois dans le système de l’état Hégélien ? La réponse est négative. La religion de l’état hégélien est le christianisme qui se déploie comme « conscience du rapport à l’Absolu » alors que l’Islam est le concept même de la philosophie de l’Esprit Absolu qui se déploie comme saisie de l’intériorité occidentale pour la libérer de son particularisme et son archaïsme, un concept de la philosophie de l’histoire.
Une conclusion s’impose tirée de la comparaison du concept de Bourguiba avec celui de Hegel.
Tout en précisant que dans le cas de l’état tunisien, il s’agit de la même religion l’islam, à la fois comme Esprit subjectif et comme esprit Absolu. Le philosophe Al-Fârâbî est d’un grand secours pour la suite de la comparaison : depuis le 10 ème siècle Al-Fârâbî avait élaboré la distinction entre deux concepts de l’Islam : ce qui relève de l’histoire de la religion musulmane, de ce qui relève du concept théorique. Ce qui nous permet de proposer une séparation séculariste à l’intérieur même de l’article 1 de la constitution tunisienne : entre l’Esprit Absolu de l’Etre-Un, c’est-à-dire l’Islam comme concept universel qui s’adresse à tous les êtres humains, dans sa version théorique cosmique qui engage la hiérarchie des êtres spirituels et la génération du monde, et l’Esprit Subjectif de l’Islam historique particulariste avec son corpus de la Charia des fukaha. Bourguiba n’a de cesse de rappeler le principe de la liberté absolue en Islam tout en appelant à une lutte acharnée contre l’archaïsme de la Tradition des cheiks de la Zitouna qui bloquent la marche de la société tunisienne vers le développement et le progrès. C’est cette dialectique hégélienne entre l’Esprit de l’Islam et l’archaïsme religieux qui est au centre d’une lecture intelligible de l’article 1 de la constitution tunisienne. C’est cette lecture qui va dans le sens des nouveaux philosophes musulmans, dans la tradition de Mohammad Iqbal, dont le plus célèbre le Français Abdennour Bidar d’un Self Islam.
Ce que proposent les frères musulmans et les wahhabites du parti islamiste Ennahda c’est un Islam réduit à une règlementation des actions humaines, à une anthropologie d’un « réchauffé de la charia cultuelle », alors que l’Islam c’est un message d’intériorisation de l’unité de dieu à toute l’humanité comme le plaide avec excellence Mohammed Talbi, dont la réflexion et les travaux fondateurs sont absents du rapport de la commission Colibe. Le génie herméneutique avec lequel Mohammed Talbi a abordé le texte coranique est à l’origine de la fondation d’une philosophie ontologique sans précédant. Mohammed Talbi libère la philosophie islamique de l’aristotélisme de Ibn Rochd, comme du platonisme de Ibn Sina. Avec son concept de « l’alliance ontologique », Mohammed Talbi a réussi là où le philosophe allemand Martin Heidegger a échoué dans sa prétention de dépasser la métaphysique. Mohammed Talbi est sans conteste le philosophe du 21 siècle dont l’héritage apportera la réponse à la crise de la métaphysique occidentale. J’y reviens prochainement dans un article consacré la philosophie de la Fitra de Mohammed Talbi, une ontologie de expérience originaire fondatrice.
Par Mohamed Hafayedh , avocat Honoraire au Barreau de Paris.