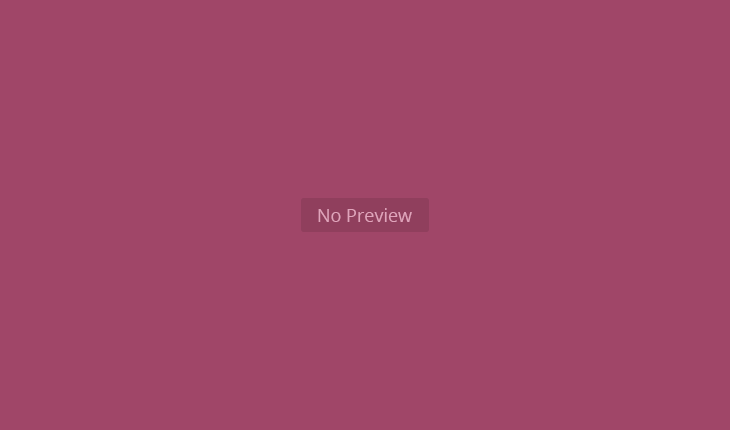Abdessalem Laarif
D’abord, deux constats :
Se décréter ministre de consciences par le premier venu devient chose banale.
L’ordre politique qui s’inspire de la foi religieuse, la détruit.
Je m’en vais battre un chemin obscur, sur lequel je n’ai nulle prétention de jeter la moindre lumière, tout au plus mon ambition m’y portera t-elle, quand je les aurai formulées, à faire que les interrogations soulevées par le déferlement de la violence islamiste sur le monde arabe et les menaces qu’elle fait peser sur la Tunisie ne soient pas seulement les miennes.
L’intégrisme religieux, à supposer même qu’il soit sincère, ce qui ne le rendrait pas moins fautif quand il dénie le droit de vivre à ceux qui lui refusent leur esprit, n’a pas épargné les sociétés les plus évoluées, occidentales en particulier, où le souvenir de l’inquisition, de la Saint-Barthélemy et de la révocation de l’Edit de Nantes, parmi tant d’autres exemples d’intolérances meurtrières, rime pourtant avec la liberté de chaque citoyen dans le strict respect de celle des autres. Les bienfaits d’un tel niveau de conscience collective, allant, faut-il le souligner, de pair avec une forme de sacralité de l’individu, ne sont pas dispensés par la nature et ont donc un prix historique. C’est à cela que je voulais en venir pour poser le problème de l’accessibilité de ce niveau du vivre ensemble, je préfère dire de vie en intelligence, à nos sociétés arabo-musulmanes sans avoir à le payer ou, tant pis, à moindre coût. Transposable, une expérience historique ne l’est certainement pas car l’histoire ne produit que du « sur mesures ». A défaut, il est aussi erroné, partant d’une proximité ou imprégnation culturelle exogène, de se dire que l’essentiel est dans les enseignements plus que dans les expériences qui les ont dégagés et que le profit en est séparément atteignable tant ce qui s’observe, en situation comme disent les psychologues, sur les comportements des individus vaut pour les groupes. Et la raison alors? Je lui oppose la réalité.
Assurément, la rationalité de la construction sociopolitique moderne la plus aboutie qui nous sert de référence, sans que nous puissions encore nous en revendiquer, ne peut lui venir que de ce qu’elle est ou se veut conventionnelle. Apportant au XVIIIème siècle l’une des lumières qui l’ont fait grand, J.J. Rousseau, puisque c’est du contrat social qu’il s’agit, s’inspirant de T. Hobbes, dit au chapitre VI de son œuvre ce qui suit : « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que, bien qu’elles n’aient peut être jamais (été*) formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues jusqu’à ce que le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle perdant la liberté conventionnelle par laquelle il y renonça. » Je ne crois pas forcer la démonstration en affirmant que cette idée est au « droit politique » ce que le postulat d’Euclide est à la géométrie plane plus que ne le fait Rousseau en y soutenant que les clauses du contrat social sont partout les mêmes et partout tacitement admises. En logique pure, comme pris au jeu de la comparaison ainsi tentée dans les deux champs de réflexion, on voit bien que la règle posée par le mathématicien athénien est assimilable à une convention puisqu’on peut la transgresser par une autre comme l’ont fait Lobatchevski puis Riemann et que la liberté conventionnelle proposée par le philosophe genevois présente tous les attributs sentencieux d’un postulat sinon il lui aurait préféré une liberté consensuelle rendant meilleur compte de ses limites acceptées par opposition à la liberté naturelle qui, dans les sociétés archaïques, est celle du plus fort. Mais objectivement, impliquer aussi indifféremment les membres de toutes les sociétés dans la souscription informelle à ses clauses me fait craindre que le contrat ne soit pour certaines d’entre elles, dont la nôtre, plus séducteur que convainquant, tel un miroir complaisant devant lequel on croit se reconnaitre dans l’image d’un autre. Pour le reste, Il faut préciser que les règles procédurales propres à traduire la volonté commune des citoyens en systèmes démocratiques de gouvernement ne sont pas en cause. De par leur portée purement instrumentale, elles sont en effet dissociables du fond contractuel auquel elles sont, plus ou moins réellement, censées donner corps, à la fortune des architectures politiques élaborées plus tard par les élites intellectuelles du XIXème siècle.
En invoquant la nature de l’acte, sans la préciser un tant soit peu, et en en faisant dépendre l’adhésion de tous, il est clair que Rousseau suppose réunies les conditions d’une adéquation entre, d’une part, les prédispositions indispensables à la manifestation d’une volonté commune d’affranchissement, et, d’autre part, le mode d’organisation des rapports sociaux propices à la liberté conventionnelle. Au demeurant, cette lacune pourrait ne pas en être une, si l’on considère que, dans l’esprit de l’auteur, le but du contrat social serait plus important que ses causes, celles-ci en préfigurant d’une certaine manière les stipulations. T.A. Ribot, professeur de psychologie au Collège de France, fin du XIXème, aurait sans doute cautionné cette démarche, lui qui, traitant de la tendance, pense que l’on porte en creux l’objet de son désir. Toutefois, les prédispositions dont il est question plus haut, ne pouvant être qu’acquises et non point innées, il importe d’interroger l’histoire sur les motifs profonds qui les ont déterminées dans le sens où des individus se sont trouvés acculés en même temps à conquérir des libertés et disposés à s’organiser pour en bénéficier ensemble et durablement.
C’est à peine si une explication fondée sur l’économie ne se présente à l’esprit comme allant de soi. L’ignorer reviendrait à pécher par omission dans un débat théorique où le matérialisme historique a toujours sa place mais a perdu, à l’épreuve du vécu, son acuité épistémologique car, à son détriment, les relations économiques, qu’elles soient compétitives ou conflictuelles, keynésiennes ou marxistes, se sont révélées trop objectives et immédiates, quoique fluctuantes aussi, pour que, de génération en génération, elles ne laissent d’autre trace persistante qu’une certaine conscience de classe, encore que dans la seconde perspective, la dictature du prolétariat, idée généreuse s’il en fût, l’ait traduite sous la forme d’un asservissement général de masse. Ce n’est pas là une digression de style mais un préalable, une précaution sans laquelle je surprendrais en affirmant que la liberté, déjà absente des thèses déterministes, peut aussi ne pas être désirée. Pour s’en convaincre, il n’est que de se rappeler comment, il n’y a pas longtemps, en 1881, l’abolition du servage a coûté la vie au tsar de Russie Alexandre II, ôtée par des mains qu’il avait libérées ou d’observer aujourd’hui, en plein XXIème siècle, la sainte horreur en laquelle les populations amorphes des monarchies de la presqu’ile arabique, si habituées à courber l’échine, tiennent la liberté. Mais puisque l’actualité s’en mêle, je me dois d’ajouter que le faux sursaut de vertu financière dans lequel la dynastie saoudienne, désemparée, place ses espoirs de survie n’y changera rien. Cette parenthèse fermée et toutes choses étant égales par ailleurs, sans oublier la peste et les guerres territoriales, nul ne mettra en doute les causes exclusivement religieuses des souffrances extrêmes subies tout au long des âges par des populations entières d’occident ni leur origine dans l’intransigeante dualité spirituelle et temporelle, autant dire le terrorisme, de l’église catholique. Nul doute non plus que, sous les foudres de l’anathème et devant les vagues de persécution qui s’étaient succédées, noyant dans le sang tout écart de l’esprit qu’aurait trahi la parole la plus innocente ou le geste le plus anodin, leur imputation à la volonté de Dieu par des mortels devait immanquablement susciter de singuliers questionnements et conduire à l’éclosion d’une liberté de conscience individuelle, première condition du contrat social. Une condition nécessaire et largement suffisante. Le reste, c’est-à-dire la marche vers les conquêtes démocratiques et l’édification de l’Etat de droit, ne pouvait que suivre selon des processus spécifiques il est vrai, mais essentiellement naturels et irréversibles. Si je devais, par un rendu imagé, retracer cette idée de la liberté portée par le Grand Siècle comme Michelet entendait le XIIIème, je dirais que, pour l’enfantement de sa réalité, la révolution, française en particulier, a servi de sage-femme portant bonnet phrygien , et un siècle plus tard, pour la mettre définitivement à l’abri des coups du sort, la laïcité de l’Etat a en quelque sorte métabolisé les souffrances prétendument dictées du ciel et évoquées dans ce qui précède. Je devine néanmoins l’improbable posture dans laquelle je puis être perçu en disant cela et ne m’étonnerais point que l’on puisse me prêter un étrange sentiment de frustration à l’endroit de mon peuple de n’avoir pas subi ces souffrances pour, non pas mériter la liberté un jour, mais pour en jouir paisiblement et toujours. Aussi je n’éluderai pas la question et avoue mon trouble devant une histoire que d’autres font pour nous. Le comble de la perversité dans ce qui nous arrive est que ce sont précisément des protestants, nouveaux comme il convient désormais de les désigner, et des israélites qui sont à la manœuvre avec la complicité servile de leurs esclaves recrutés parmi nos dirigeants. Nos ennemis n’avaient qu’à relire les pages sombres de leur propre histoire et rien à inventer. Je serais le dernier à le leur reprocher, nous sommes seuls responsables des malheurs qui s’abattent sur nous.
Les religions monothéistes ont arraché l’esprit humain au doute sur le sens de la vie, donc à une angoisse existentielle et, de ce fait, y ont suscité une forme d’abandon qui, dans le cas particulier de l’Islam, va à l’encontre de ses préceptes exigeants d’intelligence et de savoir, deux facteurs essentiels de compréhension du message de Mohammad menant à une foi vraie , non pas captée ou inoculée, mais autant cultivée qu’assumée. Néanmoins, de l’arbitrage qu’il eût fallu exercer par le premier converti à l’Islam entre des penchants intimes et des devoirs nécessairement antagonistes, on est en lieu de déduire que les notions de bien et de mal n’ont attendu nulle révélation divine pour se faire jour dans l’entendement. D’ailleurs, le Coran en témoigne qui les tient pour données immanentes. Voila me semble t-il un argument pleinement illustratif du génie relativiste de l’Islam plus communément appelé modération, ouverture ou tolérance , quoique injustement réducteur du rôle des religions au secours qu’elles portent à la morale ainsi que A. Schopenhauer s’est laissé aller à l’expédier, d’un trait de plume agacé, dans son mémoire de concours « Le fondement de la morale », publié en 1841. Bien au-delà en effet, une civilisation éblouissante, dont toute l’humanité allait profiter, naquit de l’élan intellectuel devant lequel l’Islam avait ouvert les plus larges horizons.
Par une curieuse fatalité, depuis longtemps déjà, le monde musulman apparaît comme un monde arriéré. Il ne lui manquait que de devenir barbare. De toutes parts, on a aujourd’hui beau jeu de dire que c’est chose faite. Pour en arriver là, il fallait une nouvelle religion ou, comme ce fut le cas, un ersatz tout trouvé dans les délires d’un hurluberlu nommé Ibn Abdelwahab pour en tenir lieu et servir de cause à défendre surtout contre des musulmans, avec la cruauté et la lâcheté que l’on sait. Comment se satisfaire alors des explications de cette descente en enfer tirées, surtout par habitude scolastique, des dogmes brandis comme des armes par les uns et des incantations victimaires des autres sans que ne soit d’abord dénoncée une confusion trop vieille et trop répandue auprès des fidèles ordinaires entre la foi, affaire personnelle, et les croyances, affaire de groupe? Les limites assignées au présent sujet ne permettent pas de s’y engager, aussi, en raison de leur caractère collectif, seules les dernières seront considérées dans les développements qui suivent.
L’idée que je me fais d’une croyance, prise dans le sens qu’elle a au pluriel, est celle d’un dérivatif du réel, né d’un besoin grégaire de cohésion et qui se traduit par le rattachement des contingences, des occurrences, à des repères mythologiques ou à des sources d’influences surnaturelles confinant au sacré. Rien de directement normatif ou déontique. Ce devait être le lien au moyen duquel les communautés humaines primitives se sont formées, agglomérées et fédérées ou se sont scindées et repliées sur elles-mêmes. A ce titre, les croyances sont en elles-mêmes leur propre réalité. Mais, pour autant que leur fonction ait supposé la mise en commun d’un imaginaire quelconque, rendu subliminal par une transmission ritualisée, il est plausible que leur pertinence les ait elle-même déterminées à s’écarter de la réalité concrète et objective dont la perception est partout identique. C’est en fin de compte l’invraisemblance de la chose convenue ou partagée qui en fait un code identitaire d’appartenance au groupe et un gage mutuel de fidélité. Ainsi, plus des croyances sont extravagantes, plus fort est le lien qu’elles sous-tendent. Que dire alors du sort connu par la plupart d’entre elles devant les indiscutables progrès de la science et les réalisations de technologies accessibles à tous sinon, pour le peu qui en reste et selon une formule consacrée, qu’elles ont la peau dure ? Du folklore ! C’est ce que je me suis souvent dit, porté par cette conviction que l’abandon progressif des archaïsmes, des désuétudes et des naïvetés s’inscrivait dans le sens de l’histoire. Erreur, s’agissant de nos sociétés, c’est l’inverse auquel nous assistons.
Qu’il me soit alors permis, en trois phrases, de résumer la situation « sur le terrain »: L’histoire détaillée n’est plus à faire du projet presque séculaire d’un sixième califat caressé, à ses débuts par l’organisation des frères musulmans à l’initiative de quelques chantres de l’absolu à peine lettrés, vite réduits au silence par G. Abdelnasser. D’une deuxième étape marquée par de vaines tentatives d’insertion, sous différentes appellations, de ladite confrérie dans les constructions politiques officielles, notamment en Algérie, on retiendra, en plus du sang versé, l’affinement à sa tête d’une direction, autrement plus machiavélique, qui n’a pas encore dit son dernier mot. Enfin, ce cauchemardesque « printemps arabe » a définitivement levé le voile sur la nature répugnante de l’intégrisme islamique, par ailleurs si accommodant pour les intérêts géostratégiques de quelques grandes nations prises de court par l’émergence de puissances potentiellement concurrentes, les visées territoriales d’Israël, les appétits d’une Turquie redevenue charognarde et l’instinct bestial de conservation de deux dynasties pétrolières. Tout aura été dit, beaucoup moins du rôle salvateur de l’armée égyptienne à l’échelle du monde arabe et peut être rien de ce qui se prépare dans ce laboratoire de la décadence qu’est devenue la Tunisie.
Personne n’ignore les aptitudes manœuvrières du mouvement islamiste « ennahdha », elles sont phénoménales. Qu’en on juge : après avoir déposé les assurances multiformes de sa résipiscence aux pieds d’un despote médiocre et s’être maintenue par couardise, mais aussi par calcul, à l’écart des soulèvements populaires l’ayant « dégagé », cette organisation clandestine et éparpillée s’empare prestement de l’Etat, le saborde méthodiquement, puis se montre outrageusement prodigue en conseils de prudence et de sagesse à l’adresse des tunisiens désemparés, appauvris et humiliés à l’international par ses soins. Transposées sur le plan social où se déroule réellement la gestation d’un pouvoir islamique, par autodéfinition totalitaire et pérenne, ces aptitudes seraient suicidaires en dehors d’une stratégie globale. Celle de la décomposition-recomposition de la société, pourtant prônée par les hauts dirigeants d’ « ennahdha » selon un modèle pseudo-théocratique éculé et tenant plus de l’alibi que d’autre chose, dans un environnement mondial de plus en plus irrésistiblement tourné vers le progrès matériel, est proprement diabolique. Puisant aux sources épistémiques occidentales, ceux-ci la déploient sous nos yeux endormis précisément à contrecourant du progrès général, dans un sens diamétralement opposé à celui de l’histoire précédemment évoqué à propos de croyances.
Dans cet ordre d’idées je citerai deux exemples édifiants, l’un pris au creux de la vague, à l’ouverture du grand procès des activistes islamiques de l’été 1992 au Tribunal Militaire Permanent de Tunis, l’autre, tout récent, sur les marches supérieures du pouvoir devant un auditoire acquis.
Il faut avoir entendu Sadok Chourou, alors deuxième dirigeant du mouvement, s’en prendre, devant ses juges, pendant près de deux heures, dans une langue arabe d’une richesse et d’une limpidité peu communes, aux superstitions, activités de voyance et autres déchéances culturelles favorisées par un système éducatif défaillant, fautivement ignorées ou formellement autorisées sous le régime de Ben Ali, pour s’interroger sur ce qui reste de fidéisme dans un discours où le positivisme, superbement maîtrisé, fait loi. Poussée aussi loin, la duperie est flagrante. L’homme savait trop bien ce qu’il advient d’une religion faite outil de pouvoir et arme de guerre. La foi y recule sous les assauts fébriles des instincts et les croyances compensatoires du martyre la remplacent avec force détails en rêves libidineux dans l’au-delà.
Dans un enregistrement vidéo largement diffusé sur Facebook et dont l’authenticité ne fait pas de doute, mon second témoin, un confrère avec lequel j’ai des rapports courtois, Maître Abdelfattah Mourou, premier Vice-président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ne mâche pas ses mots. Le pouvoir échu, démocratiquement dit-il en substance entre les mains de ceux auxquels il s’adresse en usant de la première personne du pluriel, devra déboucher sur l’avènement d’un état attendu depuis plus de six siècles et à la tête duquel sera exercée la tyrannie d’un tyran dont la mission consistera notamment à ôter la vie de ses contestataires. Là aussi, l’auteur de cette diatribe ne pouvait faire aveu plus explicite qu’un parti religieux est toujours une structure de combat et que l’état islamique, situation de fait et non création de droit, reste une fiction. Le contrat social y fait singulièrement défaut.
Ainsi, un lien social étant toujours indispensable, ce sera celui de la soumission par la force à la volonté d’une oligarchie, seulement, à la différence de l’Arabie Saoudite qui n’en a pas ou pas encore connu d’autre, cela ne pourra se faire en Tunisie que par sa substitution à un ordre social somme toute évolué, donc au prix d’une régression organisée. Il est certain que celle-ci se prépare et qu’elle suppose la mise à contribution d’une logique paradoxale de confrontation comme celle parfaitement moderne enseignée par Edward N.Luttwak et développée dans son livre «Le paradoxe de la stratégie» pour, une fois l’édifice actuel aplati, reproduire un processus de remodelage primitif de la société auquel la notion de contrat sera totalement étrangère. Mais, l’exemple de la Turquie, où les islamistes exercent la plénitude du pouvoir et où presque rien de tel ne s’est encore produit n’infirme t-il pas un tel propos? A cette question, je répondrai par la négative car ce qui a fait défaut à Erdogan et à son parti, pris à leur propre piège, c’est un affaiblissement de l’Etat et une déliquescence de la société conséquents à une révolution manquée comme en Tunisie ou en sursis avant d’être sauvée in extremis en Egypte, le désordre créateur en somme.
Pour y faire obstacle, les tunisiennes et les tunisiens éclairés devront surtout veiller à ne pas se laisser bercer par les chants des sirènes de Monplaisir ou gagner par l’accoutumance à leurs signes extérieurs de civilité, voire d’avant-gardisme, entérinés par des complices de tous bords. Il n’y aura pas de deuxième chance. Une vérité souvent ignorée est que les politiciens islamistes ne connaissent pas les tergiversations sur le fond de leurs desseins et surtout pourquoi il en est ainsi. Ils en sont simplement dispensés par le mensonge et la tromperie, moyens de pratique courante, d’ailleurs consacrés sur une échelle éthique assez particulière au service de ces desseins.
Que sont ces desseins, sinon les jouissances d’un pouvoir étendu sur une société que le rigorisme même dont il se drape accuse de vouloir noyer dans l’ignorance et l’immoralité ?
(*) ajouté au texte cité.
Abdessalem Larif