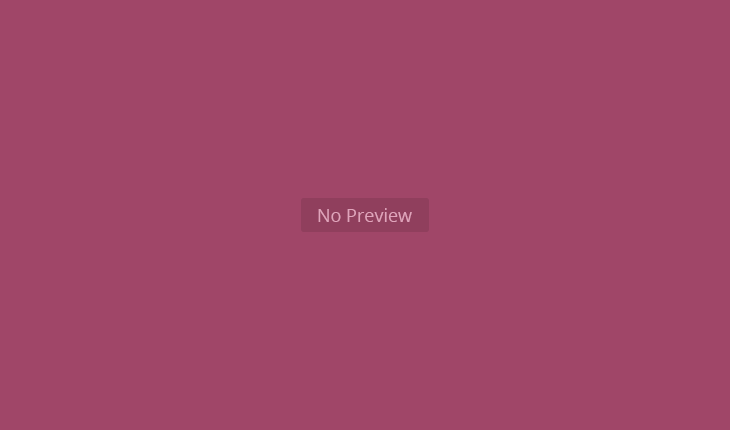L’instrumentalisation de l’histoire par des néophytes
Les conventions de l’autonomie interne et de l’indépendance ont-elles conduits à la souveraineté nationale ?
La signature des conventions du 3 juin 1955, n’a durée en fin de compte que 10 mois, la montée en puissance du conflit yousséfiste d’une part et l’indépendance marocaine le 2 mars 1956, avaient fait que la France avait repris ses calculs concernant la Tunisie. Inutile de dire que de ce fait, de nombreuses clauses des conventions de juin 1955, seront très vite dépassées. C’est à ce titre que les articles ayant trait à la sécurité nationale et la défense extérieure de la Tunisie aux mains de la France par ces conventions, deviendront obsolètes du fait que la Tunisie a pu asseoir un premier noyau d’une force armée dès le 9 avril 1956 qui prit la dénomination de Garde Nationale. 250 hommes des forces du Maghzen du sud tunisien ont pu être mobilisés afin que la Tunisie puisse avoir les moyens de sa sécurité intérieure pour faire face à la menace des bandes rebelles pro-yousséfistes. Mieux encore, la Tunisie a pu faire défiler un premier noyau de son Armée nationale le 24 juin 1956, et le 30 juin 1956 l’Armée tunisienne vient d’être créée. Avec la formation du premier gouvernement de l’indépendance le 15 avril 1956, Habib Bourguiba, étant à la fois Chef du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et Ministre de la Défense Nationale, les négociations venaient de prendre une nouvelle direction dans la stricte philosophie de la politique des étapes préconisée par H. Bourguiba.
Il faut savoir également que la Tunisie vient d’hériter un lourd fardeau de l’héritage colonial, le nouvel Etat tunisien était dépourvu de tout, et Bourguiba ayant choisi une coopération étroite avec le monde libre, ne pouvait se passer de l’aide française dans quasiment tous les secteurs, à commencer par l’Armée et son équipement.
C’est autant dire que les clauses des conventions de 1955 étant devenues obsolètes avec les nouvelles conventions de 1956. Même ces dernières ne sont au fonds qu’un cadre général et ne sont nullement signées pour résoudre toutes les nombreuses questions restées en suspend. Les négociations se sont faites âpres : il restait encore à la date de mars 1956, 22.000 soldats français stationnés sur tout le territoire tunisien. La France, et dans une tentative de forcer la main à Habib Bourguiba a voulu tergiverser pour garder sa haute main-mise, proposant une formule d’Edgar Faure « l’indépendance dans l’interdépendance ». Celle-ci fut réfutée par la Tunisie. H. Bourguiba considérait cette formule comme étant « élastique », elle toucherait ainsi le socle même sur lequel il a bâti sa lutte politique : la souveraineté nationale. Cette conception était un leitmotiv chez Bourguiba, pour s’en rendre compte, il faut revoir tous les échanges de lettres avec le Ministre des Affaires tunisiennes et marocaines pour voir la détermination de Bourguiba de se dégager de toute dépendance directe envers l’ex-colonisateur.
A cet effet, et en guise de sanction, dès le mois de janvier la France a stoppé net son aide et sa collaboration militaire pour la livraison des armes pour la Tunisie sous prétexte d’aide tunisienne à la rébellion algérienne. Pire encore, le 22 mai 1957, toute aide économique à la Tunisie était suspendue. La raison de ce blocage, Bourguiba refusait toujours et en dépit des sollicitudes françaises de signer un quelconque accord sur la cession de la base de Bizerte.
Vers la concrétisation de la notion de souveraineté nationale loin des accords de 1955 et 1956.
Comme nous l’avons précédemment mentionné, les conventions de mars 1956 seront loin de résoudre toutes les questions qui restaient en suspends. Ainsi, chaque secteur considéré comme stratégique sera régie par un accord à des dates intermittentes et ce au gré des rapports politiques entre les deux pays qui seront souvent extrêmement tendus. Ces accords par secteur vont ainsi abolir sine die tous ce que les ont précédés, ils vont désormais régir d’abord les nouveaux rapports avec la France et son héritage, et de l’autre donner l’entière responsabilité au nouvel Etat tunisien de prendre lui-même les commandes du pays. Ces accords sont consultables dans le Journal Officiel Tunisien, (JOT), qui deviendra le JORT après la déclaration de la république, nous en donnons ici une idée sommaire et la date de la signature des ces accords.
– Diplomatie et relations extérieurs : accord du 15 juin 1956 ;
– Défense nationale : accords du 21 juin 1956 et du 17 juin 1958 (ce dernier évoque la libération de tout le territoire tunisien de l’occupation militaire française à l’exception de Bizerte) ;
– Radiodiffusion : accord du 29 août 1956, applicable à partir du 31 mars 1957, cède à l’Etat tunisien le poste de «Radio Tunis ». Il a été également conclu un accord de coopération entre la RTF et Radio Tunis signé à Tunis le 7 décembre 1959 ;
– Fonction publique : protocoles des 9 mars 1957 et 15 avril 1959. (Le maintien des droits acquis des fonctionnaires français étant abolis, les fonctionnaires français pouvaient rester sous contrat). Le Gouvernement tunisien emploi actuellement (1960) 1800 agents contractuels dont 1200 au titre de l’enseignement.
– Justice : Convention du 9 mars 1957. Elle supprime la justice française de Tunisie, la justice tunisienne est désormais compétente l’égard des Français et des Européens en Tunisie.
– Régime monétaire et Banque d’émission : Protocole et convention des 19-25 juillet 1957. Abroge sine die l’exclusivité d’émission de la monnaie par la Banque d’Algérie jusqu’en 1961 telle que le stipule les accords de juin 1955. Désormais la Tunisie vient de créer sa propre banque d’émission, et le dinar est devenu la monnaie nationale. C’est dire que les accords de 1955 sur cette question n’est plus en vigueur;
– Relations économiques et douanières : accord du 5 septembre 1959.
Cette convention abroge l’union douanière et prévoit une libre circulation des produits entre les deux pays et l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée
Préférences tarifaires dont quelques unes font l’objet de contingents. Les principaux produits tunisiens bénéficient d’une franchise à leurs entrées en France. Cette convention du 5 septembre 1959 a été conclue pour un an renouvelable par toute reconduction.
Le contentieux franco-tunisien et l’affaire de Bizerte 1960 et plus tard
Les accords précités sont les principaux qui ont été conclus entre la Tunisie et la France d’autres seront complétés jusqu’en 1963 concernant plusieurs contentieux. Il restait à la date de 1960, trois grands dossiers non encore résolus :
– La base aéronavale de Bizerte ;
– Les droits civils des Français de Tunisie et le régime de leurs biens ;
– Les frontières sahariennes avec l’Algérie.
Le 12 mai 1964, la Tunisie avait nationalisé définitivement toutes les terres agricoles.
Voilà donc le long processus d’acquisition de la souveraineté nationale tunisienne. On ne parle pas d’indépendance, mais plutôt de souveraineté nationale. Tous ces accords confirment que la politique des étapes de Bourguiba avait pu soustraire la Tunisie à une domination française certaine, et que les conventions de l’autonomie interne et de l’indépendance sont largement dépassées.
Conclusion
Voici donc comment l’Etat indépendant avait largement mis en avance sa farouche lutte pour accomplir sa souveraineté nationale et ce en dépit des pressions subies et surtout par son manque de ressources financières. Nous appelons de nos vœux à ce que les Tunisiens lisent l’histoire de ce pays non par procuration à travers des personnes qui ne veulent que semer la discorde, mais par eux même et s’assurer de la tromperie que certains veulent les y induire.
L’histoire est une grande responsabilité, son écriture revient aux historiens spécialisés, et ne peut aucunement être un enjeu ou l’objet d’instrumentalisation manichéenne de certains amateurs et arrivistes !
Faysal Cherif
Partagez SVP au maximum afin que les gens sachent la tromperie de certains amateurs d’histoire et manipulateurs d’opinion!