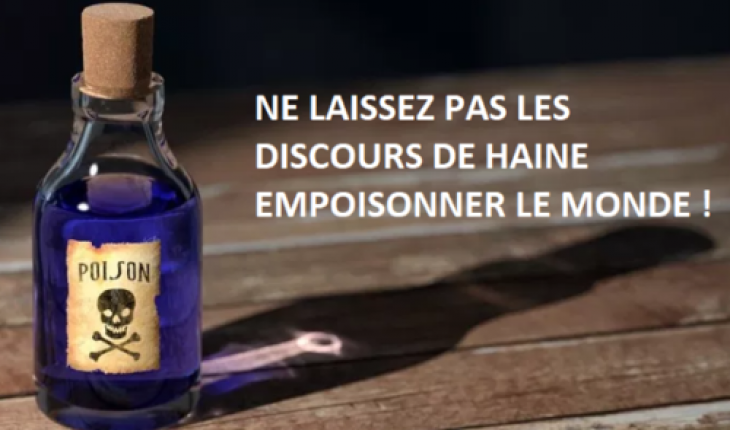La pandémie de COVID-19 suscite un élan de solidarité entre les nations et les communautés. Elle s’accompagne aussi d’un déferlement de haine et de xénophobie, alimenté par la rumeur et la désinformation sur le coronavirus. Face à ce poison qui entrave la jouissance des droits humains, freine le développement durable et menace la paix et la sécurité internationales, les Nations Unies prônent l’action à tous les niveaux de la société.
« Nous devons agir maintenant pour renforcer l’immunité de nos sociétés face au virus de la haine », a plaidé le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un appel à une « action résolue pour mettre fin aux discours de haine dans le monde entier ».
Comme le détaille une note d’orientation publiée le 11 mai par l’ONU, le phénomène prend des formes diverses, de la recherche de boucs émissaires à l’utilisation de stéréotypes, de la stigmatisation de groupes ou d’individus au recours à des propos « méprisants, misogynes, racistes, xénophobes, islamophobes ou antisémites ».
Depuis que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décrété, le 30 janvier, l’urgence de santé publique de portée internationale, des personnes d’origine chinoise ou appartenant à des minorités ethniques et religieuses sont accusées de propager le virus. Il en va de même pour certaines populations marginalisées comme les migrants et les réfugiés. Parallèlement, des théories complotistes circulent, visant pêle-mêle les juifs, les musulmans, les chrétiens ou encore les baha’is.
« Nous devons agir maintenant pour renforcer l’immunité de nos sociétés face au virus de la haine », – António Guterres, Secrétaire général de l’ONU
Partout dans le monde, des journalistes, des lanceurs d’alerte, des défenseurs des droits de l’homme, des travailleurs humanitaires et même des professionnels de la santé sont, eux aussi, la cible d’attaques haineuses en lien avec leurs actions ou travaux sur la pandémie et ses conséquences.
« Alors que nous combattons la pandémie, il nous incombe de protéger les personnes, de mettre fin à la stigmatisation et de prévenir la violence », a souligné M. Guterres, en appelant à l’implication dans ce double défi de tous les acteurs de la société.
En complément de sa Stratégie et de son Plan d’action sur les discours de haine, lancés voilà tout juste un an, l’ONU recommande aujourd’hui d’agir à cinq niveaux, à commencer par celui du Système des Nations Unies lui-même.
Les départements, agences, fonds et programmes de l’ONU priés de monter au front
Les différentes entités onusiennes sont tenues de promouvoir le respect de la liberté d’opinion et d’expression. Parallèlement, elles doivent condamner les discours de haine engendrés par la COVID-19, soutenir ceux qui les combattent et exprimer leur solidarité avec les victimes. Elles sont aussi invitées à surveiller et analyser le phénomène afin d’appuyer des réponses efficaces.
Dans une récente note analytique, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) constate que « la stigmatisation de certains groupes, tel que les migrants, en situation de crise n’est pas nouvelle ». Les maladies sont régulièrement perçues comme « étrangères », comme ce fut le cas pour le choléra dans les années 1830, du VIH/sida dans les années 1980 et plus récemment de la grippe H1N1.
Si la COVID-19 « ne fait pas exception », la stigmatisation qu’elle provoque atteint des niveaux sans précédent du fait « de l’ampleur de la pandémie, des orientations claires sur sa dénomination de la part de l’OMS, de sa couverture médiatique et des commentaires connexes sur l’instrumentalisation politique », relève l’OIM.
Pour le Directeur général de l’agence, António Vitorino, « il est évident que les forces populistes qui font des migrants les boucs émissaires de tous les problèmes sociaux dans les pays développés sont en train de mener une campagne pour profiter de la pandémie ». Laisser prospérer de tels discours risque, selon lui, de polariser davantage le débat migratoire et de réduire les voies légales pour les migrants, alors même qu’ils participent à la vie des communautés des pays d’accueil.
Afin d’aider les responsables des questions migratoires à communiquer dans des contextes complexes comme celui de la crise actuelle, l’OIM a publié un guide pratique mettant l’accent sur des approches participatives et sur l’implication des publics. L’objectif est de permettre la production de campagnes de sensibilisation, de changement de comportement et d’information, tout en réduisant l’impact de la désinformation sur la migration.
Dans le même ordre d’idées, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé le 4 mai un cours en ligne gratuit en réponse à la montée des discours de haine et d’intolérance liés à la COVID-19. Intitulé « De la haine à l’espoir : cultiver la compréhension et les capacités de résilience », il propose des solutions en matière de prévention et de sensibilisation, notamment dans l’utilisation des réseaux sociaux.
À l’attention des gouvernements, journalistes, médias et acteurs non étatiques de l’Afrique de l’Est, l’UNESCO a par ailleurs organisé, le mois dernier, un webinaire consacré aux moyens de déconstruire la désinformation et les discours de haine dans cette région à fort risque épidémique.
Les États Membres appelés à respecter les droits humains en toute circonstance
À ses États Membres, l’ONU demande de s’assurer que toutes les communications publiques concernant la COVID-19 soient « accessibles, précises, fiables, factuelles, transparentes et disponibles dans toutes les langues parlées par la population ». Elle leur demande également de ne pas attribuer la responsabilité de la propagation du virus à une communauté et de promouvoir l’inclusion.
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, fin mars, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le racisme, Tendayi Achiume, a jugé « inexcusables » les réponses politiques à la pandémie qui « stigmatisent, excluent et rendent certaines populations plus vulnérables à la violence ». Une conséquence en est que des « personnes d’origine chinoise ou est-asiatique avérée ou supposée » font l’objet d’attaques racistes et haineuses en lien avec le virus.
Le 13 mai, Mme Achiume et son homologue chargé des questions relatives aux minorités, Fernand de Varennes, ont exhorté le gouvernement bulgare à mettre fin aux discours de haine et à la discrimination raciale à l’encontre de la minorité rom dans sa réponse à la crise sanitaire. « Les autorités ne devraient pas exploiter la pandémie pour exclure davantage les Roms et les présenter comme criminels et contagieux », ont fait valoir les deux experts onusiens.
Le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, Ahmed Shaheed, s’est quant à lui ému, le 17 avril, que « certains chefs religieux et politiciens continuent d’exploiter les moments difficiles de cette pandémie pour répandre la haine contre les juifs et les autres minorités ».
D’une manière générale, l’ONU appelle les États à veiller à ce que toute mesure, législation ou politique d’urgence décidée en réponse à la pandémie soit conforme au droit international des droits de l’homme, comme le souligne le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans ses Principes directeurs concernant la COVID-19.
Les États sont par ailleurs invités à dénoncer fermement les discours de haine, la désinformation, la mésinformation et les théories complotistes, tout en garantissant que ces questions sont traitées dans les systèmes d’apprentissage, par le biais notamment de la pensée critique et de l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Les médias sociaux mis au défi de la modération humaine
Devant la flambée des messages de haine consécutive à l’apparition du virus, M. Guterres a demandé aux médias sociaux « d’en faire davantage et de signaler et de supprimer, le cas échéant, conformément au droit international des droits de l’homme, les contenus racistes, misogynes ou préjudiciables ».
Selon une étude de la société L1ght spécialisée dans la détection de contenus toxiques sur Internet, le nombre des messages de haine ciblant la Chine et des Chinois a bondi de 900% sur le réseau social Twitter depuis le début de la crise liée au coronavirus. Plus largement, le trafic sur des sites haineux a progressé de 200% sur la même période.
Face à cette inflation alarmante, l’ONU demande aux médias sociaux de s’assurer que leur politique relative aux discours de haine prévoit une évaluation du contexte social et politique, du statut et des intentions des émetteurs de messages, du contenu et de la portée de diffusion ainsi que des préjudices éventuels pour les utilisateurs et le public.
D’ores et déjà, les géants Facebook et Twitter ont revu leur politique en matière de conduite haineuse. Alors que l’épidémie devenait mondiale, ils se sont engagés à durcir leur modération et à filtrer la désinformation sur la COVID-19, à l’instar des autres grandes plateformes. Le réseau Tik Tok a pour sa part fait appel à un conseil d’experts extérieurs pour réviser ses règles de contrôle des contributions, tandis que Pinterest a choisi de recourir à l’intelligence artificielle pour détecter les mensonges. Certains contenus haineux continuent pourtant de passer à travers ces mailles.
Pour y remédier, l’ONU recommande aux médias sociaux de ne pas se fier excessivement à l’automatisation, notamment en matière de modération des contenus, et de développer des « processus d’examen humains ». L’Organisation préconise en outre une surveillance accrue des discours de haine liés à la COVID-19 sur les plateformes et une évaluation de leur impact sur les droits humains des utilisateurs.
Les médias et les journalistes invités à faire preuve d’éthique et de responsabilité
L’ONU demande aux médias en général de déclarer « de manière proactive et professionnelle » les cas de propos haineux, de désinformation, de mésinformation et de discrimination liés à COVID-19, qu’ils soient le fait d’acteurs étatiques ou non étatiques.
Elle leur propose aussi d’instituer des systèmes d’autorégulation, de type ombudsman ou médiateur de presse, afin de garantir que le droit de correction ou de réponse est appliqué aux articles ou reportages jugés discriminatoires dans le contexte pandémique.
Pour la couverture de cette crise, l’ONU appelle également les médias et leurs journalistes à adhérer aux « normes éthiques et professionnelles les plus élevées », afin de rapporter les faits avec précision et sans parti pris, en vérifiant les informations et en évitant les stéréotypes, sans se référer inutilement à des critères tels que la race, l’ethnicité, la nationalité ou la religion.
Dans cet esprit, la Fédération internationale des journalistes (FIJ), première organisation mondiale de la profession, a exhorté, début mars, ses quelque 600 000 membres répartis dans 146 pays à faire preuve de responsabilité dans cette couverture. Selon elle, « le rôle des médias est de fournir aux citoyens des informations vérifiées, exactes et factuelles et d’éviter les informations sensationnalistes susceptibles de provoquer une panique et une peur généralisées ».
Pour la FIJ, il est particulièrement crucial, dans ce contexte, de respecter la Charte mondiale d’éthique des journalistes, dont les principes constituent « le meilleur antidote contre la mésinformation, les fausses nouvelles et les théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux ».
La société civile encouragée à promouvoir l’inclusion et la solidarité
Dans ses orientations, l’ONU considère essentiel que les personnalités influentes de la société, notamment les chefs religieux, les dirigeants de syndicats et d’organisations non gouvernementales (ONG), les responsables de la jeunesse et les influenceurs, dénoncent activement la haine et expriment leur solidarité avec ceux qui en sont la cible.
Devant la montée, dans de nombreux pays, de l’ethno-nationalisme, de la stigmatisation et des discours de haine ciblant les groupes vulnérables, M. Guterres a lui-même demandé aux responsables religieux et aux organisations confessionnelles de « dénoncer activement les messages inexacts et nuisibles » et d’encourager toutes les communautés « à promouvoir la non-violence et à rejeter la xénophobie, le racisme et toutes les formes d’intolérance ».
Conformément aux normes internationales en matière de droits humains, la société civile devrait collaborer avec les parties prenantes concernées – y compris les gouvernements, les Nations Unies, les organisations régionales, les médias sociaux, les journalistes, les universitaires et les experts – au suivi de l’impact de ces fléaux en lien avec la pandémie. Son rôle est aussi de développer des réponses impliquant les communautés les plus touchées, par exemple en menant des campagnes d’information sur les réseaux sociaux, estime l’ONU.
Lundi prochain, à la suite de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix célébrée le 16 mai, plusieurs entités du Département de la communication globale de l’ONU organisent une réunion d’information en ligne à l’attention de la société civile. Son thème : « Combattre la stigmatisation, la xénophobie, les discours de haine et la discrimination raciale liés à COVID-19 ».
Parmi les intervenants attendus figurent Craig Mokhiber, Directeur du Bureau du HCDH à New York, et plusieurs représentants d’ONG en pointe sur ces problématiques, notamment Human Rights Watch (HRW), le National Council of Negro Women (NCNW), association de femmes afro-américaines, et l’Asian Americans Advancing Justice (AAJC), groupe de plaidoyer pour la communauté asio-américaine.
Source : un.org.fr