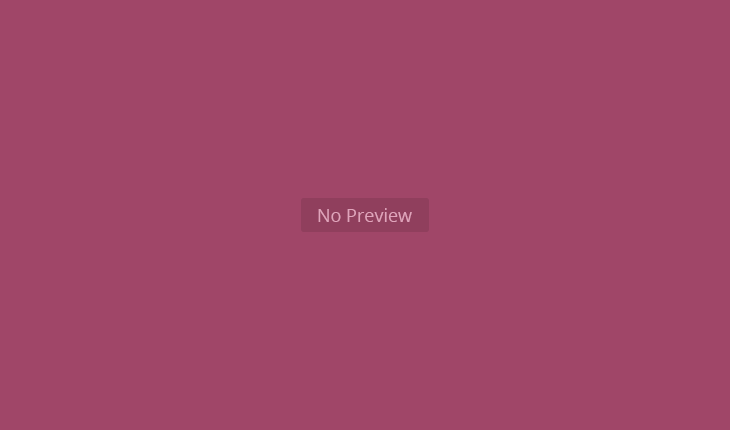À propos du secret professionnel de la profession d’avocat, je vous ai promis dans un récent statut en date du 12 de ce mois, de revenir pour apporter la contradiction à l’argumentaire soutenu par le représentant de la corporation à l’occasion du vote par l’ARP de l’article 34 de la loi de finances pour l’exercice qui pointe à l’horizon. Alors, je reviens.
Arrière-plan d’abord :
– L’objectif recherché à travers l’article 34 de la loi de finances pour l’exercice 2018 est une meilleure transparence du monde des affaires pour permettre à l’Etat de collecter le plus possible de ce qui est dû à la collectivité nationale qu’il représente. L’Etat, dans sa définition fiscale, n’est autre que l’ensemble des contribuables. L’enjeu de l’impôt est pour l’Etat un enjeu de survie et est donc d’ordre public.
– D’autres dépositaires du secret professionnel sont soumis depuis longtemps au même devoir de divulgation, en particulier, les institutions financières.
– Les professions libérales, notamment les avocats et les médecins ont toujours opposé une résistance forte à toutes les tentatives des pouvoirs publics visant à les soumettre au devoir éminemment citoyen de payer l’impôt.
– La profession se réclame d’une présomption largement partagée, mais heureusement simple, celle de détenir seule, le savoir juridique. Trop souvent, elle en abuse.
Contre-argumentaire, maintenant :
Selon la profession, l’article contesté serait « illégal » et «inconstitutionnel ».
Voici donc d’abord, un nouveau motif de non-conformité, une invention typiquement tunisienne : les « lois illégales » ou les lois contraires, non pas aux normes qui leur sont supérieures suivant la pyramide de Kelsen, mais celles qui s’opposent à elles-mêmes. Une contradiction si évidente qui voudrait qu’une chose puisse être à la fois ce qu’elle est et le contraire de ce qu’elle est ! que l’humain par exemple, puisse être inhumain !
Ensuite, l’article serait à la fois « illégal » et/ou
«inconstitutionnel ». C’est donc à la carte ou pour copier Jean de La Fontaine « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère ». (2)
L’inconstitutionnalité semble avoir été appréciée par rapport à l’article 105 de la Constitution de 2014 qui dit ceci : «La profession d’avocat est libre et indépendante ; elle participe à l’instauration de la justice et à la défense des droits et des libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales le protégeant et lui permettant d’exercer ses fonctions». Aucune allusion, voyez-vous, à la notion de secret professionnel.
La profession, si j’ai bien saisi les propos de son représentant, promet alors de confier à un collège d’experts, le soin de démontrer le statut constitutionnel du principe.
Une promesse vaine, car le collège n’en trouvera pas. A ce propos, nous renvoyons tout simplement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de l’Hexagone qui décline toute valeur constitutionnelle au secret professionnel « aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » dit le Conseil. (Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015).
Quant à la prétendue illégalité de l’article 34, elle semble renvoyer en réalité à la disposition objet de l’article 6 du Décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011 portant organisation de la profession, qui impose à l’avocat de prêter le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant, d’exercer mes fonctions en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel et de respecter les principes de la profession d’avocat et ses valeurs ».
En invoquant cet article, la profession semble conférer au serment une sacralité et une portée absolue qui l’immunisent contre toute exception qui pourrait être posée de temps à autre, par la loi. Ceci est faux et nous vous dirons pourquoi.
Disons tout de suite que le principe du secret professionnel est un principe légal. En Tunisie, il est consacré par de nombreuses lois et protégé par l’article 254 du Code pénal qui punit « (…) toutes (…) personnes qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets, auront (…) révélé ces secrets ».
Il s’agit ici du principe. Mais ce principe n’est pas absolu, car l’article 254 s’empresse de préciser que les dépositaires du secret peuvent le divulguer lorsque « LA LOI LES OBLIGE OU LES AUTORISE A SE PORTER DENONCIATEURS ». L’article 254 admet donc expressément les exceptions au principe du secret et nous dit aussi que ces exceptions doivent être apportées par la loi. Dans sa décision de 2015 sus-évoquée, le Conseil constitutionnel français délimite avec une clarté d’eau de roche, le périmètre du secret professionnel : «Considérant qu’il incombe au législateur d’assurer la CONCILIATION entre, d’une part, la PREVENTION DES ATTEINTES A L’ORDRE PUBLIC ET DES INFRACTIONS, NECESSAIRE A LA SAUVEGARDE DE DROITS ET DE PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis (…)».
Au premier rang de ces principes de valeur constitutionnelle, figure bien évidemment celui de « l’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques, conformément à un système juste et équitable ». ( Article 10 de la Constitution tunisienne). A cet effet, la loi fondamentale met à la charge de l’Etat « de mettre en place LES MECANISMES PROPRES A GARANTIR LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT ET LA LUTTE CONTRE L’EVASION FISCALE».
En somme donc, c’est plutôt le devoir fiscal qui a un statut constitutionnel, mais point le principe du secret professionnel.
N’étant pas absolu, le principe du secret n’est pas non plus un principe sacré. La solennité qui entoure le serment ne confère au siège juridique qui l’abrite aucune supériorité dans l’ordonnancement juridique par rapport aux autres supports de même rang. Le devoir pour le banquier par exemple, ou pour le fonctionnaire, de respecter le secret professionnel, n’est ni plus lâche ni moins exigeant que celui qui incombe à celui qui prête serment. Différemment, tout le monde devrait jurer ! La réalité est que le serment n’est autre que le pendant de l’indépendance d’une profession (avocats, médecins, etc.) ou de l’exercice d’un pouvoir de commandement ou d’un privilège exorbitant du droit commun (charges élective, présidentielle, gouvernementale, juridictionnelle, etc. Il est en un mot, un garde-fou éthique, l’ultime rempart contre l’abus, car il interpelle la seule chose qui nous habite ad vitam : la conscience. Parti en voyage, Solon n’avait que le serment des Athéniens pour s’assurer que les lois qu’il leur avait laissées ne soient pas modifiées pendant dix ans!
Par le serment, chaque professionnel indépendant proclame solennellement être le gardien des valeurs de sa profession et son adhésion à ces valeurs et s’engage à les protéger à l’égard de ses pairs bien sûr, mais également à l’égard de la société tout entière. Toutefois, jeter un voile pudique sur des pratiques que la loi réprouve, détourner les yeux de violations de la règle, voire, encourager ces violations, conduit inévitablement à vider la norme juridique de sa substance et, pour être pragmatique, de son utilité, outre que cela conduit également à perturber fortement le système économique d’une nation et, au-delà, son système social. (3)
La règle déontologique doit venir en soutien de la règle juridique, COMME UN MODE D’EMPLOI. Mais elle ne doit pas s’y substituer sous peine de fragmenter le champ de la règle. FORCE DOIT RESTER A LA LOI.(4)
Samir Brahimi
__________________
(1) Jean-Louis DEBRÉ Président du Conseil constitutionnel de la République française ; « L’importance du serment, de sa solennité et l’importance de l’éthique dans le droit » ; Séance de serment des experts-comptables ; Lyon 22 septembre 2009.
(2) Fables (1668 à 1694), Livre premier, X, le Loup et l’Agneau.
(3) Jean-Louis DEBRE; Op.Cit.
(4) Jean-Louis DEBRE; Op.cit.
Illustration : capture d’écran d’une vidéo publiée sur la page Facebook de l’Ordre des avocats tunisiens lors de leur dernière manifestation contre cette loi