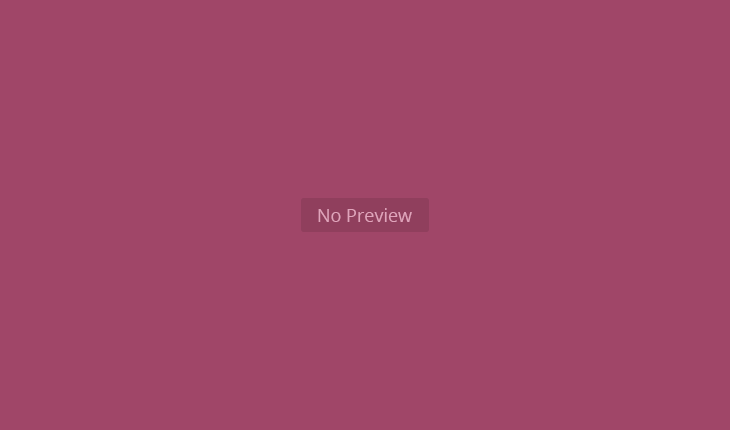Chady Hage-ali
Il y a 30 ans, le 15 octobre 1987, mourait assassiné le président burkinabé et panafricain Thomas Sankara.
Aujourd’hui, cette figure emblématique et martyre de la lutte anti-impérialiste et anticoloniale est encore admirée et célébrée par une jeunesse africaine qui ne l’a pas connue, alors même qu’elle ne se prend plus à rêver de nouvelles révolutions. Les soleils des indépendances africaines et leurs lendemains chantants se sont éclipsés depuis fort longtemps.
Thomas Sankara peut trôner dignement aux côtés des illustres « pères fondateurs » de l’Afrique postcoloniale que sont Sylvanus Olympio, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah Léopold Sédar Senghor, Modibo Keita et Nelson Mandela, pour ne citer qu’eux.
Mais Thomas Sankara ne revendiquerait peut-être pas ce statut ni ne se sentirait forcément proche idéologiquement de tous ces hommes.
Il n’était certes pas le plus intellectuel, diplômé et diplomate d’entre eux, mais il était un leader d’une insoumission absolue, un foudre d’éloquence, doté d’assez d’esprit, de caractère, de sincérité et de pugnacité pour marquer son temps et laisser une trace indélébile de son passage.
Par tempérament, formation et idéologie, il était davantage camarade et frère que père de la nation des « hommes intègres ».
Sa fringance, son verbe décapant et sans concession envers ses adversaires, son regard pétillant d’espièglerie, mais aussi sa droiture et la fidélité qu’il témoignait à ses semblables lui donnaient à la fois l’étoffe du véritable compagnon de route et celle, moins ordinaire mais tout aussi noble, du héros romantique.
On le compare souvent, à tort ou à raison, à l’Argentin Ernesto Guevara avec lequel il partage, outre un charisme certain et des idéaux révolutionnaires, une jeunesse figée dans l’éternité et un patronyme à trois syllabes se terminant par le même suffixe et qui résonne comme un cri de ralliement du fond des âges.
Mais la figure de Sankara s’intercale plutôt entre un Patrice Lumumba en treillis et un Lénine moins austère. Leader africain singulier, à la fois visionnaire et gestionnaire, sobre comme un anachorète, discipliné et soucieux d’exemplarité, à même de sceller, comme peu de figures paternalistes occidentales et a fortiori de dirigeants africains de son époque s’en montraient capables chez eux, la synthèse de l’éthique de la conviction et de la responsabilité.
Ce qu’Aimé Césaire disait de Victor Schœlcher vaut pour Thomas Sankara qui était bien de « la lignée de l’homme révolutionnaire : celui qui se situe résolument dans le réel et oriente l’histoire vers sa fin ». Perspective combien désarmante et inquiétante pour ses faux frères et ses adversaires extérieurs, la volonté de Thomas Sankara de transformer le réel laissait augurer une possible prouesse inédite et précoce pour l’Afrique et le tiers monde indépendants, autrement dit dangereusement contagieuse et en contradiction avec l’histoire déjà écrite pour eux par l’homme blanc.
Ainsi Sankara voulait-il bâtir, en fédérant les forces du peuple burkinabé, de ses femmes et hommes de toutes les classes et de tous les mérites, un État-nation social et solidaire, situé aux antipodes des utopies communautaires ou collectivistes dévoyées en Occident dans le totalitarisme.
Y serait-il parvenu ? Nous ne le saurons jamais mais l’aventure avait bien commencé. Sa vision souverainiste, cohérente et claire, énoncée dans ses discours consistait à changer les mentalités asservies et à réduire progressivement toutes les formes de la dépendance néocoloniale.
Pour ce faire, il fallait d’abord créer, rationaliser et favoriser les filières de la production vivrière nationale pour ainsi atteindre en priorité l’autosuffisance alimentaire et ne plus avoir à subir les effets de la détérioration des termes des échanges commerciaux et le cercle vicieux de l’endettement qui ne bénéficiaient qu’aux multinationales et aux institutions financières contrôlées par les puissances du centre capitaliste. Ce devait être la première étape avant d’espérer l’indépendance intégrale.
« Les meilleurs partent toujours les premiers » a-t-on coutume de dire. Le sort des révolutionnaires au cours de l’histoire, tout au moins les plus convaincus, dévoués, tenaces et impavides d’entre eux, ne semble démentir la portée généralisante de ce proverbe. Les pétrisseurs de peuples et les forceurs de destin ne deviennent presque jamais vieux, et meurent presque toujours brutalement. Somme toute, ne sont-ils peut-être pas d’assez fins manœuvriers, perméables au pragmatisme politicien qui touche parfois au cynisme, ou sont-ils trop robespierriens et jusqu’au-boutistes pour être aptes aux compromis avec leurs propres convictions.
Rien, hormis la mort, ne peut les arrêter : immodérés dans leurs ambitions et projets mélioratifs, impatients et scrupuleux à l’exécution de leur devoir, exigeants à l’excès envers eux-mêmes et leur époque, souvent beaucoup moins enclins à penser l’histoire qu’à la faire dans l’urgence, dans un élan empreint de vivacité frondeuse et de pureté désinvolte.
Thomas Sankara était sans doute de ceux-là, mais il était avant tout un digne fils de l’Afrique, prêt à inscrire en lettres de feu sur l’écorce aride et cendrée de sa terre mère les mots « liberté » et « responsabilité » qui s’exigent mutuellement.
Il n’avait guère besoin de réintroduire l’Afrique dans l’histoire, car elles cheminaient déjà depuis toujours ensemble. Thomas était leur enfant, leur souffle commun, lui, l’Abel africain, promesse féconde arrachée de force à sa mère nourricière, comme tant d’autres soleils noirs.
Chady Hage-ali
Photo d’illustration : portrait de Thomas Sankara par l’artiste-peintre Dada Wa.